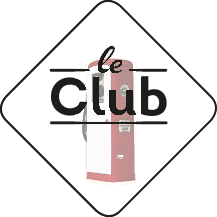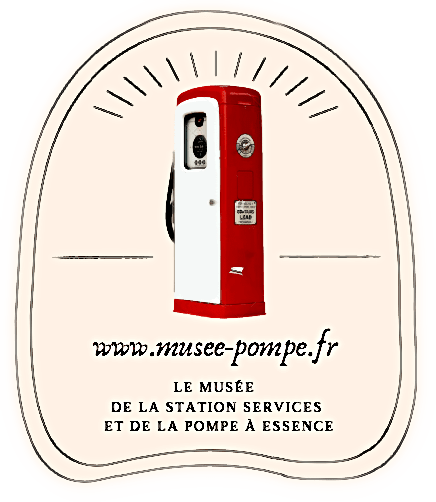Web « musée de la
POMPE À ESSENCE et de la STATION SERVICE »
Vous venez d’entrer sur le site, français, dédié aux pompes à essence (anciennes et récentes) et plus largement au monde de la station services et toute collection sur le sujet (petrolina).
Dernières nouveautés
Nos dernières mises-à-jours

LES PLAQUES, PUBLICITÉS BIDONS D’HUILES, OBJETS DIVERS ...
Mises à jour de la rubrique dédiée aux objets divers (bidons, affiches…)
(03/10/2023)

AVIA
Refonte complète des pages AVIA International, ainsi que la page AVIA France.
(14/08/2023)
à découvrir ici ?
Le site étant le plus important site français (+ de 100 pages, un club et un blog) sur le sujet de la station services, et plus précisément sur les pompes à essence, nous avons classé les pages sous divers rubriques :
- Objets divers
- Divers
- Le Club
Découvrez vos annonces
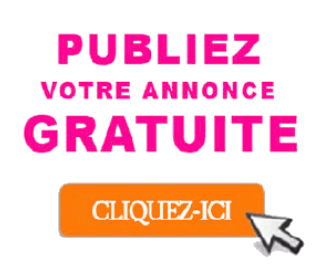
« Le musée de la station services et de la pompe à essence » vous propose une rubrique d’annonces proposées par, et pour, nos lecteurs et visiteurs.
100% gratuit : Aucune transaction entre le site est les annonceurs / acheteurs
Histoire / culture
Découvrez ici tout l’univers de la station et des pompes sur notre blog historique.
Galerie d'image


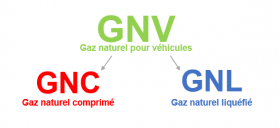
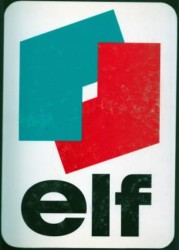










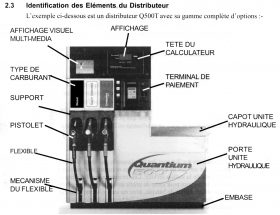

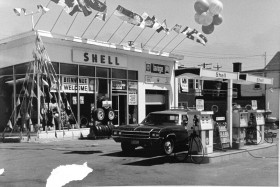
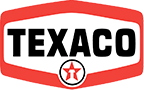
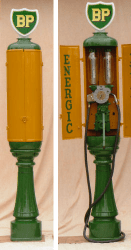


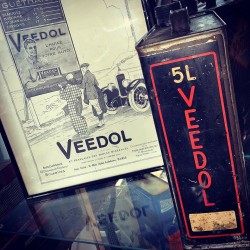


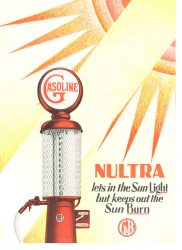
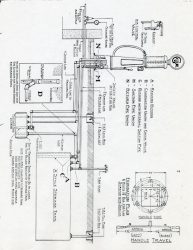

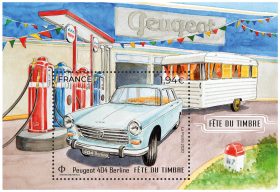
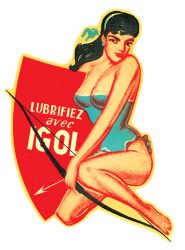



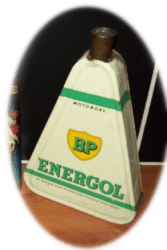


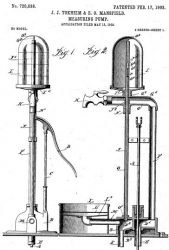



![East_Meadow_Parking_lot[1]](https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1962/01/East_Meadow_Parking_lot1-280x207.jpg)


Partager vos envies sur les reseaux sociaux
Proposer un événement
Vous organisez un rendez-vous dédié à l’automobile, une brocante, un marché aux puces…
Du moment que vous acceptiez d’y promouvoir le monde de la stations services (bidons d’huile, pompes à essences, cartes postales, affiches…) vous pouvez ajouter gratuitement vos événements .